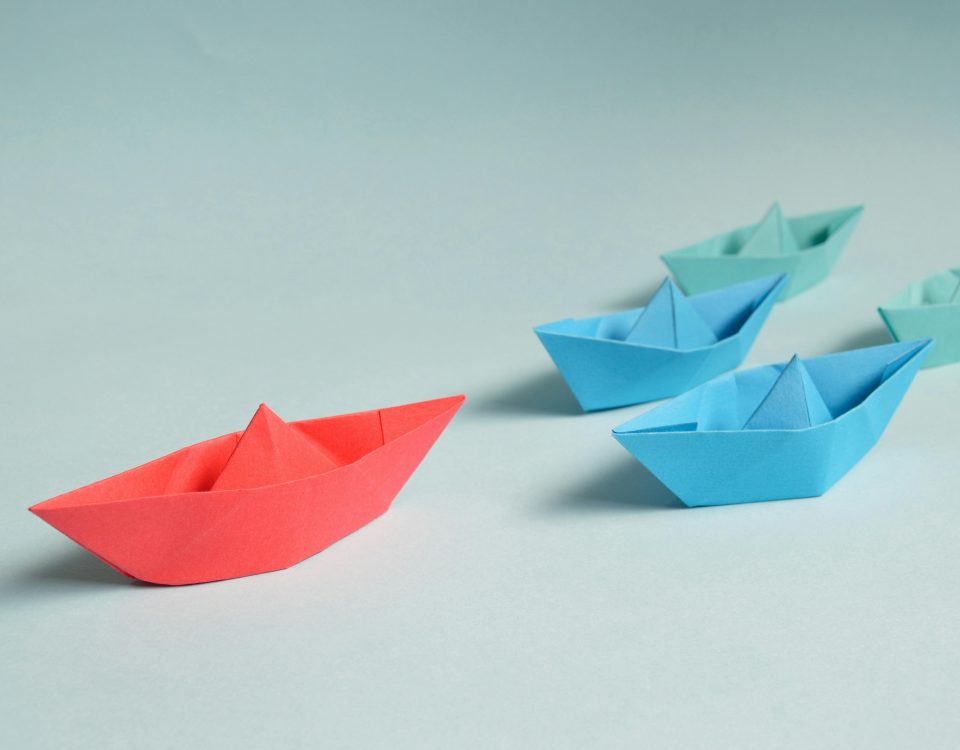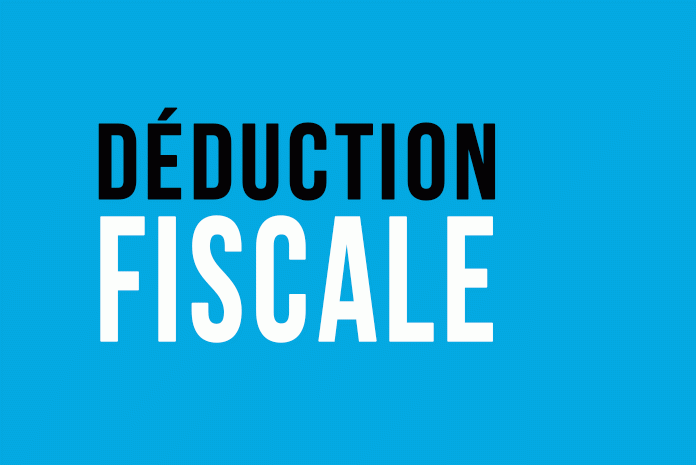Le bailleur, mal-aimé des procédures collectives (suite)
Le propriétaire de murs affectés à l’activité d’une entreprise objet d’une procédure collective subit une pénalisante singularité (GP 2 avril 2011 /Droit des entreprises en difficulté 2011, n°91, p.4) et https://www.varoclier-avocats.com/articles-juridiques/le-bailleur-mal-aime-des-procedures-collectives
1/Avant le changement d’état de sa débitrice, rares sont les cas où le bailleur parvient à récupérer la jouissance juridique et effective des locaux qui lui appartiennent. En effet, au prix parfois d’une grande créativité, la jurisprudence diffère l’opposabilité à la procédure collective de la résiliation du bail.
Pour la Cour de cassation, le bail est un contrat toujours en cours, si au jour de l’ouverture de la procédure collective, la décision de justice relative à sa résolution n’est pas passée en force de chose jugée au sens de l’article 500 CPC, i.e. non-susceptible de recours suspensif d’exécution (Cass.Com. 17 janvier 1995, 90.18.439 n°143).
La solution a été reconduite sous l’empire de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 (Com 28 octobre 2008, n°07-17.662 B 184).
2/ Après l’ouverture de la procédure collective, le bailleur est soumis à un régime légal spécifique ; il n’est pas traité comme les autres cocontractants puisqu’à l’exception des I et II de l’article L 622-13 qui lui sont communs, le contrat de bail est régi par les articles L 622-14 et L 622-15 du Code de Commerce.
Ces articles sont rédigés pour favoriser la poursuite du bail du locataire défaillant.
Ainsi à la différence des autres cocontractants, le bailleur ne peut interroger l’administrateur ou le mandataire judiciaire sur leurs intentions ; du moins ne sont-ils pas tenus de répondre. (L 622-14 et L 641-12 en matière de liquidation judiciaire). Pourtant le sort du bail n’est pas anodin ni superflu ; au même titre que les assurances, il est un sujet immédiat à examiner en vue de garantir la pérennité d’exploitation de la « débitrice » ou permettre la cession de ses actifs incorporels.
A cet effet, législateur et jurisprudence privilégient le preneur en matière de bail commercial.
– Ainsi sur le plan formel, l’administrateur peut notifier sa décision unilatérale de ne pas poursuivre le bail, laquelle prend effet à réception de la RAR. Cette non-continuation du bail vaut résiliation immédiate, sans que l’administrateur judiciaire ait à en formuler demande expresse (L 622-14-1°)
– En outre, la débitrice bénéficie d’un délai de carence de 3 mois au cours duquel il n’est tenu ni de répondre au bailleur qui l’interroge, ni davantage de payer les loyers dus. Ce régime de faveur est spécifique au bail car la poursuite de tout autre contrat exige au contraire de l’administrateur qu’il s’assure que son administrée sera en mesure d’exécuter à bonne date les clauses du contrat et notamment payer comptant, lorsque la prestation promise consiste dans le paiement d’une somme d’argent (L 631-14 al.2)
Ainsi, pendant ce délai de paix blanche, le propriétaire ignore le sort de son contrat et ne peut ni agir en paiement de ses créances de loyers et charges relatives à une occupation pourtant postérieure au jugement d’ouverture, ni à défaut demander la résiliation du bail. Ce n’est qu’au terme de ce délai que le bailleur recouvre ses droits.
Deux voies parallèles et autonomes s’offrent alors à lui pour faire constater la résiliation du bail : agir sur le fondement habituel de la clause résolutoire du bail ou opter pour la voie spéciale ouverte par l’article L 622-14-2° du Code de commerce.
Enflammé par des décisions de justice parfois surprenantes, un débat doctrinal animé a prospéré à propos de cette alternative offerte au bailleur, afin d’en apprécier les conséquences juridiques et judiciaires. Pourtant cette agitation fugace ne se justifiait guère.
En effet, quand le bailleur se prévaut de la clause résolutoire, le régime applicable est celui du droit commun des baux commerciaux, savoir commandement de payer, ensuivi d’un probable octroi de délais judiciaires requis par l’entreprise en difficulté, avec faculté pour le bailleur d’obtenir un titre ordonnant l’expulsion du débiteur récalcitrant, faute pour le débiteur de respecter le moratoire judiciaire obtenu.
Si à l’inverse, il opte pour l’article L 622-14-2°, il dépose requête, à l’expiration du délai de 3 mois (courant à compter du jugement d’ouverture), pour faire constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges dus postérieurement. Cette voie exclut alors l’application du régime des baux commerciaux. Ce texte autonome n’offre aucun pouvoir d’appréciation au juge-commissaire saisi, qui doit constater et prononcer la résiliation si le bailleur justifie du défaut de paiement de 3 mois de loyers et charges postérieurs. Cette résiliation doit être constatée au jour du dépôt de la requête devant le Juge-commissaire (C. cass 21 février 2012, n°11-11.512).
Dans le même esprit d’autonomie du texte, la Cour de cassation estimait que le juge-commissaire devait se borner à constater la résiliation, ne pouvant ni suspendre ses effets, ni accorder de délais de paiement sur le fondement de l’article L 145-41 alinéa 2 ou de l’article 1343-5 du Code civil, ni prononcer l’expulsion du locataire.
Ainsi, en pratique, dès qu’il avait connaissance par la réception du greffe d’une copie de la requête, le preneur n’avait plus moyen de faire obstacle à la résiliation ; en effet, le juge devait « constater » le défaut de paiement et prononcer la résiliation au jour du dépôt de la requête. La jurisprudence estimait jusqu’alors, que le juge devait se placer à cette date pour apprécier si les conditions d’application du texte étaient remplies.
La Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 22 février 2024 (n° 23 /12488) a encore jugé : « la résiliation du bail (…) prend effet au jour du dépôt de la demande du bailleur (…)« Ainsi qu’il est admis en jurisprudence, les conditions de résiliation de plein droit du bail doivent donc être appréciées au jour de la requête »
En parade chronophage à ce texte efficace, une connivence délétère s’est d’ailleurs développée au sein de certains greffes consulaires, visant à différer l’instruction administrative de la requête et/ou retarder la date de comparution des parties devant le juge-commissaire, au détriment délibéré des droits du bailleur. En outre et malgré la clarté du texte, nombreux juges-commissaires ont pratiqué résistance, avec le soutien de leur Tribunal, voire de la Cour du ressort.
Cette attitude reflète une volonté de faire primer l’économie sur le droit et accorder du temps aux mandataires de justice pour réaliser les actifs ; mais ce parti pris méconnait pourtant la loi et les droits du bailleur, dont les intérêts sont aussi respectables que ceux de son locataire.
La jurisprudence a connu stabilité : CA Paris, Pôle 5 – Chambre 8, 3 juillet 2012 n°11/11724 // CA Aix-en-Provence, 8ème Chambre A, 21 février 2013, n°12/07700 // CA Bordeaux, 2ème chambre civile, 29 juin 2015, n°14/07310).
Mais un arrêt rebelle de la Cour d’appel de Paris (Pôle 5 Chambre 8) du 4 avril 2018 (n°17/19289) jugea à rebours, que la délivrance d’un commandement de payer, demeuré infructueux était un préalable, même au visa de l’article L622-14 du Code de commerce, estimant qu’il ne dérogeait pas aux dispositions de l’article L145-41 C.com, quel que soit le juge saisi et qu’ainsi devant le juge-commissaire, un liquidateur pouvait obtenir des délais de paiement, ainsi que la suspension des effets du commandement.
Cet arrêt schismatique a même été approuvé par une partie de la doctrine, alors que l’article L622-14 du Code de commerce ne prévoit nullement la délivrance d’un commandement de payer préalable à sa mise en œuvre, contrairement à l’article L145-41 du Code de commerce,
Par ailleurs, Il s’agit d’une disposition spéciale et autonome introduite par la loi de Sauvegarde, dont la mise en œuvre est indépendante du mécanisme contractuel de la clause résolutoire. Enfin, même soumis à un régime spécifique, le bail commercial demeure un contrat en cours et passé le délai de grâce de 3 mois, le loyer dû doit enfin être payé, à peine pour le juge-commissaire de devoir constater la résiliation demandée par le bailleur, au jour du dépôt de sa requête. Pas plus qu’il ne peut ordonner l’expulsion, il ne peut accorder de délais de paiement mais simplement constater la résiliation.
C’est donc sans grande surprise que la Cour de cassation a sanctionné la Cour d’appel de Paris, pour avoir ajouté à la loi, une condition qu’elle ne comportait pas, en exigeant que fût préalablement délivré un commandement de payer (arrêt 9 octobre 2019 (18-17563)
La situation semblait depuis apaisée et le bailleur savait à quoi s’en tenir jusqu’un arrêt pré-estival différant au jour de l’audience, la date à laquelle l’impayé devrait être apprécié par le juge-commissaire. (12 juin 2024 -22-24177). La haute juridiction a ainsi approuvé ainsi une Cour d’appel ayant validé l’analyse d’un juge-commissaire refusant de constater la résiliation, au prétexte qu’au jour où il a statué, les loyers avaient été payés par le preneur.
Autrement dit, la défaillance du débiteur ne s’apprécierait plus au jour du dépôt de la requête saisissant le juge-commissaire, mais « au jour où il statue ». L’emploi de ces termes inquiète et marque une nouvelle entorse aux droits du bailleur et un artifice supplémentaire offert aux mandataires judiciaires pour gagner du temps.
Si seule l’audience devient la date-couperet, le dépôt d’une requête n’aura alors plus d’effets irréversibles et vaudra au mieux comme ultime alerte adressée au preneur d’avoir à régulariser sa situation au plus tard à J-1, avant de se présenter devant le juge.
Cette interprétation accentuerait le mauvais traitement du bailleur et stimulerait la tendance déjà avérée à différer l’audiencement des requêtes déposées et/ou prononcé de l’ordonnance du juge commissaire, alors exposés à inertie et longs retards, cette lecture permettant de différer opportunément la sanction judiciaire, dès lors que c’est le juge-commissaire qui fixe la date de son audience. Ainsi dans l’espèce jugée, l’ordonnance a été rendue le 1er février 2021, soit plus de 4 mois après la saisine du juge-commissaire (10 septembre 2020).
Dans l’arrêt d’appel ainsi confirmé (CA Paris 22 septembre 2022 (n°21/14862) justifiait déjà la position du juge-commissaire, en prétendant que le défaut de paiement était une « condition de fond de la résiliation » devant s’apprécier « au jour de l’introduction de la requête ».
Cette référence ne figure pourtant pas dans le texte ; l’alinéa 2 de l’article L 622-14-2°. vise uniquement le délai de trois mois et stipule simplement qu’il n’y a pas lieu à résiliation, si le paiement est intervenu « avant l’expiration de ce délai », ce qui a contrario, autorise à induire qu’au-delà, le paiement est tardif et ne peut plus faire obstacle à la résiliation.
Cette analyse de la Cour d’appel avait déjà pour effet d’allonger le délai légal ; mais celle de la Cour de cassation va encore plus loin en décidant que la date à prendre en compte est celle à laquelle le juge-commissaire statue.
Dans le même esprit protecteur, la Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 22 février 2024 (n°23/12488) soulignait déjà :
« S’il résulte de l’article L622-14 alinéa 2 qu’il n’y a pas lieu à résolution du bail lorsque le paiement intervient dans le délai de trois mois, il ne peut en revanche en être induit, en l’absence d’indication en ce sens dans le texte, que tout paiement intervenant après l’expiration de ce délai et avant la saisine du juge-commissaire est sans effet sur le constat de la résiliation du bail, alors qu’une telle interprétation aurait valeur de sanction »
Si la tendance de la jurisprudence est de toute évidence protectrice du « débiteur », encore faut- il ne pas ajouter au texte et apporter une condition supplémentaire à sa mise en œuvre.
En l’absence de précision apportée par la Cour de cassation, convient-il sans doute de ne pas surinterpréter sa décision, rendue dans un contexte très singulier, puisque le jour où le bailleur a déposé sa requête, il était établi qu’il avait reçu paiement des loyers et qu’ainsi sa créance était éteinte (§9 de l’arrêt).
Au demeurant, en homothétie avec la jurisprudence antérieure, un arrêt de la Cour d’appel de Rennes a depuis été rendu le 3 septembre (RG n° 23/07201), fixant la résiliation du bail au jour du dépôt de la requête, notamment pour infirmer une ordonnance objet d’une requête postérieure du mandataire judiciaire demandant à être autorisé à céder le fonds de commerce, alors même que le droit au bail avait disparu et le fonds perdu son lieu d’exploitation.
En revanche, si contre toute attente, la Cour de cassation devait confirmer sa jurisprudence, le débiteur pourrait s’abstenir de payer ses loyers jusqu’à la veille de l’audience. Le bailleur serait alors enclin à privilégier la voie classique de la clause résolutoire, puisque même au prix de délais de paiement, il pourrait ainsi obtenir une ordonnance prononçant la résiliation et l’expulsion du preneur défaillant, faute de respecter le moratoire judiciaire accordé.
Jacques Varoclier
Avocat à la cour