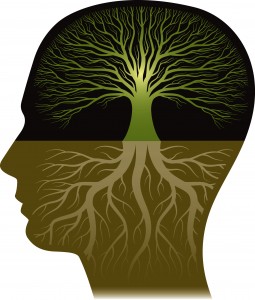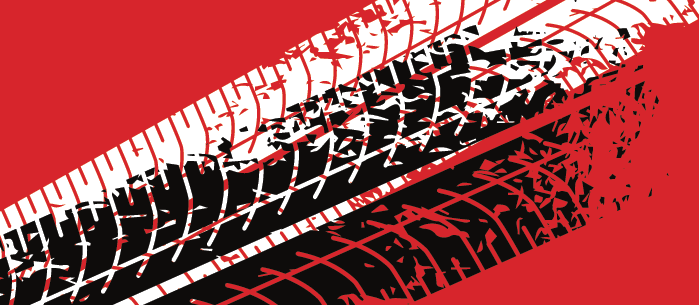Dans un petit traité au succès foudroyant, La civilité puérile, paru en 1530, Erasme insistait sur la bienveillance qui doit présider aux relations avec autrui. Cette notion s’est affinée et consolidée autour de l’idée d’une sociabilité assise sur un mode de relations pacifiques et distantes, à l’abri de gestes, signes ou comportements offensifs, rustres ou impulsifs.
Dès le XVIIème siècle, ont fleuri de nombreux traités de savoir-vivre, codes nobiliaires ou curiaux qui se sont progressivement affranchis des frontières des trois ordres du royaume pour, à l’époque des Lumières, devenir un programme d’éducation, où la civilité est une illustration de la victoire de la raison sur les passions. Il s’agit de privilégier les bonnes manières et le respect mutuel.
Aujourd’hui, la civilité sonne comme un terme générique, englobant « politesse » et « savoir-vivre », pour désigner une pratique élégante des usages de la vie en société, favorisant le vivre-ensemble dans des conditions de neutralité axiologique. Le terme s’est imposé comme une vertu républicaine, tandis que la « politesse » plus connotée bourgeoise, était méprisée pour ses facticité et superficialité, suggérées par son étymologie, issue du latin polire, désignant l’action de polir ou orner. Le processus semble pourtant s’inverser, au point qu’aujourd’hui on parle surtout des « incivilités ».
En pratique, politesse et savoir-vivre s’unissent pour faire civilité et promouvoir l’art du vivre-ensemble : mise en scène de la convivialité, gradation, codification ou hiérarchie des initiatives, des rituels de communication…
Le but commun est d’instaurer des réflexes et comportements respectueux d’autrui, propices à une pratique courtoise, voire gracieuse des usages de la vie en société. Cette forme de déontologie, variable selon les cultures, vise à fluidifier les relations humaines ; elle régit autant l’esthétique, l’hygiène que la morale et articule toutes les dimensions de la vie sociale.
Ce code de bonnes conduites répond à des nécessités fonctionnelles mais n’exclut pas amabilité, bienveillance, discrétion et sobriété, autant de qualités corrélées au respect de soi et d’autrui, ou la recherche d’une homéostasie sociale harmonieuse. Bergson distingue la politesse des manières, de l’esprit et du cœur ; leur juste équilibre inspire soin de soi, son corps ou sa tenue, car l’on est jugé sur sa mine et sa mise, mais encore un respect attentionné d’autrui, compatible pour les plus empathiques, avec la délicatesse.
Ce savoir-vivre est une architecture d’usages homogènes destinés à réguler les échanges, mais aussi préserver l’intimité de la vie privée, par une gestion optimale de la sociabilité, cet art de vivre ensemble sans souffrir de promiscuité. Cette réserve suppose un sens de l’eunomie, i.e. la bonne distance pour ne pas s’imposer, ni faire intrusion sur le territoire d’autrui. Cette zone d’intimité varie selon le degré de proximité relationnelle ou affective. Le tact est alors une aptitude singulière et bienvenue pour capter l’évanescence de l’instant et ressentir ce qu’il est judicieux de dire, faire, taire ou s’abstenir, afin de ne pas gêner les autres, respecter leur intimité, besoins ou désirs.
Ainsi la politesse devient plus qu’un rituel factice et suranné ; elle est aussi une grammaire des liens sociaux. Sa frivolité n’est qu’apparente et procède d’une confusion entre forme et surface. Pourtant, comme en littérature, « La forme est essentielle et absolue ; elle vient des entrailles mêmes de l’idée » (Victor Hugo Proses philosophiques).
Dès lors, la politesse aussi peut refléter un socle de valeurs éthiques ; si sa pratique n’est pas simplement mimétique, mais une urbanité mue par l’élégance et pratiquée avec finesse, elle devient distinction morale en donnant à la politesse ses lettres de noblesse.
Jacques Varoclier
Avocat à la Cour